
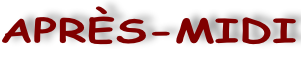


ESPÉRANCE DE VIE Sans Handicaps




La digestion est le processus complexe qui transforme les aliments que nous mangeons en nutriments suffisamment petits pour être absorbés par notre corps et utilisés comme énergie, pour la croissance ou la réparation cellulaire.
Ce processus combine des actions mécaniques (broyage, brassage) et chimiques (action des enzymes).
La Bouche (Cavité Buccale)
Le voyage commence dès qu'un aliment entre dans la bouche.
Organes en jeu : Les dents, la langue, les glandes salivaires.
Fonction mécanique : La mastication. Les dents coupent, déchirent et broient les aliments en plus petits morceaux. La langue mélange ces morceaux à la salive et les façonne en une boule molle appelée le bol alimentaire.
Sécrétions et enzymes : Les glandes salivaires produisent la salive.
La salive contient de la mucines (qui lubrifie les aliments pour faciliter la déglutition) et une enzyme clé : l'amylase salivaire (aussi appelée ptyaline).
Rôle de l'enzyme : L'amylase salivaire commence la digestion chimique des glucides complexes (comme l'amidon présent dans le pain ou les pâtes) en sucres plus simples (maltose).
La Déglutition et le Passage dans l'Œsophage
Une fois le bol alimentaire formé, il est prêt à être avalé.
Organes en jeu : Le pharynx, l'épiglotte, l'œsophage.
Fonction mécanique : La déglutition est un acte réflexe. En avalant, l'épiglotte (un petit clapet cartilagineux) bascule pour fermer l'accès à la trachée et empêcher les aliments d'entrer dans les voies respiratoires. Le bol alimentaire passe ensuite dans l'œsophage.
Dans l'œsophage, des contractions musculaires ondulatoires et involontaires, appelées péristaltisme, poussent le bol alimentaire vers l'estomac. Ce trajet dure quelques secondes.
Sécrétions : L'œsophage sécrète du mucus pour continuer à lubrifier le passage des aliments. Aucune digestion enzymatique n'a lieu ici.
L'Estomac, un Mixeur Acide
Le bol alimentaire arrive dans l'estomac, une poche musculaire en forme de J.
Organe en jeu : L'estomac.
Fonction mécanique : Les parois musculaires très puissantes de l'estomac se contractent pour réaliser un brassage intense. Ce brassage mélange le bol alimentaire avec les sucs gastriques pendant plusieurs heures.
Sécrétions et enzymes : Les parois de l'estomac sont tapissées de glandes qui sécrètent les sucs gastriques. Ceux-
De l'acide chlorhydrique (HCl) : Il crée un environnement très acide (pH entre 1,5 et 3,5) qui tue la majorité des bactéries et virus ingérés et commence à dénaturer les protéines (les "dérouler" pour les préparer à la digestion).
De la pepsine : C'est l'enzyme principale de l'estomac. Elle est sécrétée sous une forme inactive, le pepsinogène, et activée par l'acide chlorhydrique.
Du mucus : Il tapisse la paroi interne de l'estomac pour la protéger de l'acidité et de l'action de la pepsine.
Rôle de l'enzyme : La pepsine commence la digestion des protéines en les découpant en plus petits fragments appelés polypeptides.
À la fin de cette étape, le mélange semi-
L'Intestin Grêle, le Cœur de la Digestion et de l'Absorption
Le chyme quitte l'estomac par petites quantités pour entrer dans l'intestin grêle, un long tube replié (environ 6 mètres) où se déroule la majeure partie de la digestion et la quasi-
Organes en jeu : L'intestin grêle, et deux organes annexes cruciaux : le pancréas et le foie (via la vésicule biliaire).
Fonction mécanique : Le péristaltisme continue de faire avancer le chyme, le mélangeant aux diverses sécrétions.
Sécrétions et enzymes :
1. Le Suc Pancréatique (produit par le pancréas) : Déversé dans le duodénum, il est alcalin pour neutraliser l'acidité du chyme. Il contient un cocktail d'enzymes puissantes :
Amylase pancréatique : Poursuit la digestion des glucides.
Trypsine et Chymotrypsine : Continuent la digestion des protéines et polypeptides en fragments encore plus petits.
Lipase pancréatique : L'enzyme principale pour la digestion des lipides (graisses).
2. La Bile (produite par le foie, stockée dans la vésicule biliaire) : Également libérée dans le duodénum, la bile n'est pas une enzyme. Son rôle est d'émulsionner les graisses, c'est-
3. Le Suc Intestinal (produit par la paroi de l'intestin grêle) : Il contient les enzymes de la "finition" :
Peptidases : Terminent la digestion des protéines en coupant les derniers fragments en acides aminés.
Disaccharidases (lactase, sucrase, maltase) : Terminent la digestion des glucides en coupant les sucres doubles en sucres simples (glucose, fructose, galactose).
Absorption : La paroi interne de l'intestin grêle est recouverte de millions de replis, de villosités et de microvillosités, offrant une surface d'absorption gigantesque (équivalente à un terrain de tennis). Les nutriments finaux (acides aminés, glucose, acides gras, glycérol, vitamines, minéraux, eau) traversent cette paroi pour passer dans le sang et la lymphe et être distribués à tout l'organisme.
Le Gros Intestin (Côlon)
Ce qui n'a pas été digéré ou absorbé dans l'intestin grêle (principalement les fibres alimentaires, de l'eau et des cellules mortes) passe dans le gros intestin.
Organe en jeu : Le gros intestin (côlon).
Fonction principale : Il n'y a plus de digestion enzymatique ici. La fonction principale est l'absorption de l'eau et des électrolytes (sels minéraux) restants. Cela permet de compacter les résidus.
Rôle du microbiote intestinal : Le gros intestin abrite des milliards de bactéries (le microbiote ou "flore intestinale") qui jouent un rôle essentiel. Elles fermentent les fibres alimentaires non digestibles, produisant des gaz et des composés bénéfiques. Elles synthétisent également certaines vitamines, comme la vitamine K et des vitamines du groupe B.
Le résultat est la formation des matières fécales ou fèces.
La Défécation
C'est l'étape finale du processus digestif.
Organes en jeu : Le rectum et l'anus.
Fonction mécanique : Les matières fécales sont stockées dans le rectum. Lorsque celui-
Durée des Étapes de la Digestion et Variabilité selon les Aliments
La durée totale de la digestion est très variable d'un individu à l'autre et en fonction de nombreux facteurs, notamment le type d'aliments consommés, la quantité, et même l'état de stress. On peut néanmoins donner des estimations moyennes pour chaque grande étape :
Dans l'estomac (1 à 5 heures) : C'est une étape cruciale où les aliments sont brassés et dégradés par les sucs gastriques. La durée de séjour dans l'estomac, appelée vidange gastrique, dépend fortement de la composition du repas :
Glucides : Les aliments riches en glucides (pâtes, riz, pain) sont digérés le plus rapidement, quittant l'estomac en 1 à 2 heures.
Protéines : Les protéines (viande, poisson, œufs) nécessitent un temps de digestion plus long, de l'ordre de 3 à 4 heures.
Lipides (graisses) : Ce sont les plus longs à digérer. Un repas riche en graisses peut stagner dans l'estomac pendant 4 à 5 heures, voire plus. C'est pourquoi un repas gras "pèse sur l'estomac".
Dans l'intestin grêle (6 à 7 heures) : C'est ici que la majeure partie de l'absorption des nutriments a lieu. Le chyme (la bouillie alimentaire venant de l'estomac) progresse lentement pour permettre aux nutriments de passer dans le sang. Cette durée est relativement constante, bien qu'un repas très riche puisse légèrement ralentir le processus.
Dans le côlon ou gros intestin (10 à 70 heures) : Le résidu non digéré arrive dans le côlon. À ce stade, il n'y a plus de digestion à proprement parler, mais une absorption de l'eau et des électrolytes, ainsi qu'une fermentation par le microbiote intestinal. Les résidus sont ensuite stockés avant d'être évacués sous forme de selles. La variabilité est ici très importante et dépend de facteurs comme l'hydratation, la teneur en fibres du régime alimentaire et la motilité intestinale de chacun.
Temps de Transit Complet d'un Petit Objet Non Digestible
Pour un petit volume d'un aliment ou d'un objet non digestible (comme un pépin de fruit ou un petit marqueur radiologique utilisé en médecine), le temps de transit complet moyen est généralement estimé entre 24 et 48 heures.
Ce temps peut cependant varier considérablement, allant jusqu'à 72 heures ou plus chez certaines personnes en parfaite santé, notamment celles ayant un transit naturellement plus lent.
Quelle Attitude Adopter Après le Repas (Post-
Le repos complet avec sieste : S'allonger complètement après un repas peut favoriser le reflux gastro-
L'exercice physique calme, dit "digestif" : C'est l'option la plus recommandée. Une marche légère d'une quinzaine de minutes après le repas a plusieurs avantages :
o Elle stimule la motilité intestinale de manière douce, aidant le bol alimentaire à progresser.
o Elle aide à réguler la glycémie (le taux de sucre dans le sang) après le repas, en particulier après un repas riche en glucides.
o Elle favorise la circulation sanguine générale sans pour autant créer un "vol" de sang au détriment du système digestif, contrairement à un effort intense.
L'exercice physique intense : Un effort intense (course à pied, musculation, etc.) est fortement déconseillé juste après un repas. Le corps doit alors dévier massivement le flux sanguin vers les muscles sollicités, au détriment de l'estomac et des intestins. Cela peut entraîner une mauvaise digestion, des crampes, des nausées et des ballonnements.
Il est généralement conseillé d'attendre au moins 2 à 3 heures après un repas complet avant de pratiquer une activité physique intense.
En résumé, la meilleure attitude post-
une marche digestive calme.
Elle représente le compromis idéal pour accompagner le travail de votre système digestif sans le perturber.
Composition de la salive :
La salive est principalement composée d'eau (environ 99%). Le 1% restant contient :
**Composés inorganiques **: des ions tels que le sodium, le potassium, le chlorure, le calcium, le phosphate et le bicarbonate. Ces ions jouent un rôle dans le maintien du pH de la salive, la protection des dents et la digestion.
**Composés organiques **: des protéines, des enzymes (comme l'amylase qui commence la digestion des glucides), des glycoprotéines, des mucines (qui lubrifient la bouche et protègent les tissus), des hormones, des anticorps et d'autres substances.
**Cellules épithéliales **: des cellules des muqueuses buccales qui se desquament et se retrouvent dans la salive.
Un adulte produit en moyenne entre 0,5 et 1,5 litre de salive par jour. La production de salive varie en fonction de différents facteurs, tels que l'hydratation, l'alimentation, le stress et certaines maladies.
Autres caractéristiques de la salive :
**pH **: La salive a un pH légèrement acide à neutre (entre 6,5 et 7,5), ce qui est optimal pour l'activité des enzymes digestives et la protection des dents contre la déminéralisation.
**Viscosité **: La salive est visqueuse en raison de la présence de mucines, ce qui lui permet de lubrifier la bouche et de faciliter la mastication et la déglutition.
Mode d'action de la salive :
**Digestion **:
- L'amylase salivaire commence la digestion des glucides dès la bouche.
- La salive humidifie également les aliments, ce qui facilite la formation du bol alimentaire et sa progression dans l'œsophage.
**Protection des dents **:
- La salive contient des ions qui aident à neutraliser les acides produits par les bactéries et à reminéraliser l'émail des dents, les protégeant ainsi contre les caries.
- Elle contient également des substances antibactériennes qui aident à contrôler la croissance des bactéries dans la bouche.
**Lubrification **:
- La salive lubrifie la bouche, ce qui facilite la mastication, la déglutition et la parole.
**Goût **:
- La salive dissout les substances chimiques des aliments, ce qui permet aux papilles gustatives de les détecter et de nous donner la sensation de goût.
**Maintien de l'équilibre hydrique **:
- La salive contribue à maintenir l'hydratation de la bouche et des muqueuses.
En résumé :
La salive est bien plus qu'un simple liquide. Sa composition complexe et ses multiples fonctions en font un élément essentiel de notre santé bucco-
Voici quelques recommandations validées et documentées pour prévenir les caries dentaires et les gingivopathies, et pour maintenir un microbiote buccal sain. Ces recommandations sont principalement axées sur une bonne hygiène bucco-
Hygiène bucco-
Brossage des dents : Brossez-
Nettoyage interdentaire : Utilisez quotidiennement du fil dentaire ou des brossettes interdentaires pour éliminer la plaque et les résidus alimentaires entre les dents, là où la brosse à dents n'atteint pas. L'hydropulseur peut être un complément utile.
Dentifrice fluoré : Le fluor est essentiel pour renforcer l'émail des dents et prévenir les caries. Utilisez un dentifrice fluoré adapté à votre âge (pour les enfants, la concentration en fluor doit être adaptée).
Gratte-
Bains de bouche : Utilisez-
Alimentation équilibrée :
Limiter les sucres : Les sucres sont la principale source de nourriture pour les bactéries cariogènes qui produisent des acides attaquant l'émail des dents. Évitez les bonbons, les boissons sucrées, les pâtisseries et les grignotages fréquents entre les repas. Si vous consommez des aliments sucrés, buvez un verre d'eau ou mâchez un chewing-
Aliments riches en fibres : Les fibres stimulent la production de salive, qui aide à nettoyer la bouche et à neutraliser les acides.
Aliments riches en calcium et phosphates : Les produits laitiers, les noix et certains légumes (comme le brocoli) renforcent l'émail des dents.
Hydratation : Buvez suffisamment d'eau tout au long de la journée pour favoriser la production de salive, essentielle pour neutraliser les acides et éliminer les particules alimentaires.
Visites régulières chez le dentiste :
Contrôle annuel : Des visites régulières chez le dentiste (au moins une fois par an) sont indispensables pour un suivi efficace, un détartrage professionnel et la détection précoce des caries ou des problèmes de gencives.
Applications de fluor/scellants dentaires : Le dentiste peut recommander des applications de fluor ou la pose de scellants dentaires, notamment chez les enfants, pour une protection supplémentaire contre les caries.
Éviter les habitudes nocives :
Tabagisme : Fumer réduit le flux sanguin vers les gencives, nuit à la cicatrisation et favorise la croissance de bactéries pathogènes, augmentant significativement le risque de gingivopathies.
Consommation excessive d'alcool : L'alcool peut assécher la bouche et perturber l'équilibre du microbiote buccal.
Maintenir l'équilibre du microbiote buccal :
Au-
Éviter l'abus de bains de bouche antiseptiques : Comme mentionné, une utilisation excessive peut tuer les bonnes bactéries et déséquilibrer la flore.
Probiotiques bucco-
Mastication : La mastication stimule la production de salive, ce qui est bénéfique pour le microbiote.
Éviter les antibiotiques inutiles : Les antibiotiques peuvent avoir un impact sur l'ensemble du microbiote, y compris celui de la bouche.
En suivant ces recommandations, vous maximisez vos chances de prévenir les caries, les gingivopathies et de maintenir un microbiote buccal sain, essentiel pour une bonne santé bucco-
LES REGIMES POUR PERDRE DU POIDS SONT CONTRE PRODUCTIF
Explications
- Perte de tissu musculaire lors d'une perte de poids rapide : C'est un fait établi. Lorsqu'une personne perd du poids rapidement, en suivant un régime trops hypocalorique elle ne perd pas seulement de la graisse, mais aussi une part significative de sa masse musculaire.
- Reprise de poids majoritairement graisseux : Lorsque le régime est arrêté et que les habitudes alimentaires reprennent, le poids repris est souvent majoritairement sous forme de graisse. Cela s'explique par le fait que le corps, ayant été privé, a tendance à stocker davantage d'énergie sous forme de graisse en prévision d'une future restriction.
- Rôle du métabolisme de base et de la masse musculaire : Le métabolisme de base (MB) représente la quantité d'énergie que votre corps brûle au repos pour assurer ses fonctions vitales. Il est fortement corrélé à la masse musculaire : plus vous avez de muscles, plus votre MB est élevé, et plus vous brûlez de calories même au repos.
- Le cercle vicieux de l'effet yo-
yo et la sarcopénie : La succession de régimes restrictifs et de reprises de poids entraîne une diminution progressive de la masse musculaire (sarcopénie), cela a pour conséquence directe une diminution du métabolisme de base.
- Impact d'une alimentation "normale" après l'effet yo-
yo : C'est la conclusion logique et souvent frustrante de ce processus. Avec un métabolisme de base diminué, une personne qui mange des quantités qui étaient "normales" pour elle avant le cycle de régimes, ou même des quantités modérées, peut se retrouver en surplus calorique et reprendre du poids. J’ai entendue parfois "une feuille de salade me fait grossir !"Ce qui illustre bien cette réalité perçue par ceux qui sont pris dans ce cycle.
Corrections
- Pour une perte de poids saine, durable et respectueuse de la physiologie du corps
- Il est impératif de ne jamais conduire un régime sans :
- Une activité physique, en particulier la musculation (entraînement en résistance), est cruciale pour maintenir, voire augmenter, la masse musculaire pendant une période de restriction calorique. Cela permet de préserver un métabolisme de base élevé et d'améliorer la composition corporelle (plus de muscle, moins de graisse). L'exercice cardio-
vasculaire est aussi important pour la dépense calorique et la santé cardiovasculaire globale. - Une Alimentation au minimum normo-
protidique (voire hyperprotéique) : Les protéines jouent un rôle essentiel dans la préservation de la masse musculaire lors d'une perte de poids. Elles ont également un pouvoir satiétogène élevé, ce qui aide à réduire la faim. Une alimentation suffisamment riche en protéines est donc indispensable pour limiter la perte musculaire et favoriser l'adhésion au régime
- La perte de poids ne doit pas être une simple question de "manger moins", mais une démarche globale qui intègre une alimentation équilibrée (avec un accent sur les protéines), une activité physique régulière (y compris la m
L’approche pour être durable doit être personnalisée
BOUTADES PERSONNELLES SUR LES REGIMES
"On maigrit en dormant" et "Faire régime fait grossir"
Ce sont des réalités physiologiques importantes !
- "On maigrit en dormant" : C'est vrai ! Comme nous venons de le voir, votre corps dépense de l'énergie même au repos pour assurer son métabolisme de base. Pendant votre sommeil, votre cœur bat, vos poumons respirent, votre cerveau travaille, vos organes filtrent... toutes ces fonctions consomment des calories. Et on passe beaucoup de temps « a ne rien faire physiquement » (Sédentarité)
- Le sommeil de qualité est même crucial pour la gestion du poids. Un manque de sommeil peut perturber les hormones de la faim (leptine et ghréline), augmenter le stress (cortisol) et réduire la motivation à l'activité physique, ce qui rend la perte de poids plus difficile. Donc, non seulement vous maigrissez en dormant, mais un bon sommeil optimise également vos efforts diurnes !
"Faire régime fait grossir" : Cette phrase choc est une brillante provocation qui met en lumière l'effet yo-
Régime restrictif → Perte de poids rapide (incluant du muscle) → Diminution du Métabolisme de Base -
Donc, oui, "faire régime" au sens de "suivre un régime restrictif et mal conduit" mène souvent à une prise de poids à long terme et une altération de la composition corporelle.
Cela renforce l'idée qu'il faut adopter un mode de vie sain et durable plutôt que des "régimes" temporaires.
C’est une clé de voûte de la gestion du poids sur le long terme.
Caractéristiques du Métabolisme de Base
Le Métabolisme de Base (MB), ou Métabolisme Basal (MB), représente la dépense énergétique minimale nécessaire à l'organisme pour assurer ses fonctions vitales au repos complet. C'est l'énergie consommée par votre corps pour simplement "vivre" : respirer, faire battre votre cœur, maintenir votre température corporelle, faire fonctionner votre cerveau, vos reins, votre foie, etc.
Le MB est influencé par plusieurs facteurs :
- Masse Maigre (surtout musculaire) : C'est le facteur le plus déterminant, le tissu musculaire est métaboliquement beaucoup plus actif que le tissu adipeux (graisse). Plus vous avez de muscles, plus votre MB est élevé.
- Sexe : En général, les hommes ont un MB légèrement plus élevé que les femmes, principalement en raison d'une masse musculaire plus importante et d'une plus faible proportion de graisse corporelle en moyenne.
- Âge : Le MB diminue progressivement avec l'âge, principalement à cause d'une diminution naturelle de la masse musculaire et des hormones.
- Taille et Poids : Les personnes plus grandes et plus lourdes ont généralement un MB plus élevé car leur corps a besoin de plus d'énergie pour maintenir ses fonctions.
- Génétique : Il existe des variations individuelles importantes liées à l'héritage génétique.
- Hormones : Les hormones thyroïdiennes jouent un rôle majeur dans la régulation du MB. Des déséquilibres (hypothyroïdie, hyperthyroïdie) peuvent significativement l'affecter.
- Température corporelle et environnementale : Une fièvre ou un environnement très froid augmentent le MB pour maintenir la température corporelle.
- État de santé : Certaines maladies (ex : cancer) peuvent augmenter le MB.
Organes et Fonctions les plus consommatrices d'énergie au repos
Même si le muscle est le principal contributeur à la dépense énergétique au repos globalement, certains organes spécifiques sont de véritables "gourmands" en énergie par unité de poids :
- Cerveau : Bien qu'il ne représente que 2% du poids corporel, le cerveau consomme environ 20% de l'énergie basale. C'est un organe très actif, même au repos (pensée, maintien des fonctions vitales, etc.).
- Foie : Très métaboliquement actif, il est impliqué dans d'innombrables processus (détoxification, synthèse de protéines, métabolisme des nutriments).
- Reins : Essentiels pour la filtration du sang et l'équilibre hydrique.
- Cœur : Pomper le sang en permanence est une tâche énergivore.
- Muscles : Même au repos, les muscles maintiennent un certain tonus et brûlent des calories. Cependant, c'est lorsqu'ils sont sollicités (activité physique) que leur dépense énergétique augmente drastiquement.
| Dèjeuner |
| La sieste |
| Activitèes Pro |
| Trajet |
| À DOMICILE |
| Le réveil |
| Le petit dèjeuner |
| L'habillage |
| La toilette |
| LE TRAJET |
| Trajet allée |
| ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES |
| Conditions de travail |
| Environnement humains |
| Habitat |
| Souper |
| Distraction |
| Toilettes |
| Intimitée |
| PRÉPARATION À L'ENDORMISSEMENT |
| CARACTÉRISTIQUES DU SOMMEIL |
| Caractèristique de la Chambre |
| Activités favorisantes |
| Cycles du sommeil |
| Sommeil et viellissement |
| Pathologies du sommeil |
| Sommeil et lumiére |