
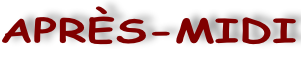


ESPÉRANCE
DE VIE
…EN BONNE SANTé



MAJ 25 07 2025
LE STRESS UNE PERSPECTIVE GLOBALE
Le stress est le mécanisme permettant d’ajuster le fonctionnement de l’organisme au plus près de la demande toujours changeante de son environnement.
Il peut être considéré comme une fonction physiologique avec
- Des entrées (perception intéroceptive et extéroceptive)
- Un intégrateur cérébral (évaluation de la valeur et de la maîtrise du stresseur, etc.)
- Des effecteurs (axe corticotrope, Systéme Nerveux Autonome)
- Une régulation au sein des effecteurs en regard de l’évolution du stimulus.
Cette manière de décrire cette fonction « stress » permet de considérer la réponse physiologique de l’organisme en fonction des caractéristiques de l’agression en intensité et durée, et de considérer la réponse pathologique comme un défaut de régulation du stress.
Causes du Stress (Stresseurs)
- L’argent
- Le travail
- La parentalité
- La politique
- La santé
- Les changements majeurs de la vie.
- La perte de contrôle
- L’imprévisibilités
- La nouveautés
- L’atteinte de l’ego.
En être attentif est une étape cruciale pour apprendre à le gérer efficacement.
Les sources du stress peuvent être variées :
Externes et liées à notre environnement ou aux événements de la vie.
- Chaleur
- Froid
- Agression physique ou psychique, etc.
Internes de notre corps et liées aussi à nos pensées, nos croyances ou nos attentes.
- Hémorragie
- Sepsis
- Douleur
- Mémoire, etc.
Sous des formes différentes
- Chroniques qui se présentes de manière constante dans notre vie.
- Aigus et survenant de manière soudaine et intense.
La particularité du stress au travail qui se défini par une situation ou existe un déséquilibre entre l'effort et la récompense de l'effort ou bien par une charge de travail importante, mais aussi beaucoup de poste nécessite la gestion d’informations complexes qui peuvent favoriser le « syndrome de l’imposteur » facteur de stress chronique.
Le changements dans le travail et la peur de ne pouvoir s’adapter, joue aussi un rôle
Mécanismes Physiologiques et Cellulaires du Stress
C’est le cerveau qui interprète une information corporelle inhabituelle et active un mécanisme de défense
Plusieurs régions dans le cerveau entrent alors en action.
- L'amygdale reçoit en permanence des informations sensorielles brutes provenant de nos sens (vue, ouïe, odorat, etc.). Elle évalue rapidement ces informations afin de détecter les stimuli potentiellement menaçants ou dangereux pour l’organisme.
- Lorsqu'elle détecte une menace, elle active le système nerveux et hormonal du stress et envoie des signaux à l'hypothalamus.
- L'hypothalamus active alors le système nerveux sympathique qui prépare l'organisme à réagir face au danger en déclenchant la libération d’adrénaline.
- L’adrénaline provoque une augmentation du rythme cardiaque, de la tension artérielle, de la fréquence respiratoire et de la vigilance.
- L’axe hypothalamo-
hypophyso- surrénalien (HHS) entraîne la libération de cortisol, une hormone stéroïdienne qui a de nombreux effets sur l’organisme, notamment l’augmentation du taux de sucre dans le sang et la suppression du système immunitaire. - L’organisme libère les forces et l’énergies nécessaires pour faire face à la menace perçue.
- L’hippocampe participe à la régulation de l’humeur, et plus globalement à l’adaptation à l’environnement.
Au moins cinq hormones sont en cause dans les manifestations physiques du stress.
- Noradrénaline
- Cortisol
- Adrénocorticotrophine (ACTH)
- Ocytocine
- Vasopressine.
Ce système endocrinien s’amplifie et s’autorégule
Au moins 6 neurotransmetteurs entre en action
- GABA (acide gamma-
aminobutyrique). Qui régule l’anxiété en diminuant l’activité des neurones sur lequel il se fixe - Sérotonine
- Glutamate
- Noradrénaline
- Acétylcholine
- Dopamine.
Le système nerveux autonome est sollicité
- L’activation sympathique accompagne les interactions avec le monde, elle implique une forte consommation d’énergie (fonctionnement catabolique).
- L’activation parasympathique participe à la récupération et à la reconstruction du corps.
Dans le cerveau, l’intense libération de catécholamines active la libération de radicaux libres, d’antioxydants avec processus d’inflammation
- L’activation de la microglie, renforcée par l’irruption de cellules immunocompétentes en son sein provoque une neuro-
inflammation associée à des altérations du fonctionnement neuronal. - La réaction inflammatoire est encore amplifiée par la libération de débris cellulaires, activant les voies du stress cellulaire.
Le stress non ajusté s’accompagne aussi d’une intense activation cérébrale indispensable à la réponse coordonnée, entraînant un défi énergétique pouvant aller jusqu’à l’apparition de mécanismes excito-
Il en résulte une activation mitochondriale excessive tentant de fournir l’énergie à la cellule mais au prix d’une production de radicaux libres.
La dysfonction mitochondriale pourrait ainsi être une des clés de la mal adaptation d’un organisme à un environnement via le développement d’une charge allostatique cellulaire.
La voie finale conduit à l’installation de lésions post-
Chez les patients victimes de TSPT (Troubles du Stress Post Traumatique), et plus généralement lors des pathologies de stress interviennent des mécanismes cellulaires avec une hyperactivité des médiateurs du stress, soit:
- Une agression continue par les radicaux libres
- Une inflammation subintrante
- Un excès d’activation cérébrale via l’excito-
toxicité - Des défauts de reconstruction de l’organisme etc.
- L’adaptation cellulaire se dote alors des capacités de production d’énergie, de détoxification des radicaux libres et de protection des protéines face à cette dénaturation.
- Ces mécanismes de l’adaptation cellulaire modifient en retour la réponse de l’organisme à l’agression.
Classification des Différents Stress
Les sources de stress peuvent être
Aiguës
Le stress aigu est mobilisateur, l’attention est focalisée sur l’agent stressant, les sens sont en alerte, les hormones sont produites et la situation est plus ou moins vite gérée.
Chroniques
Le stress chronique est affaiblissant, il découle d’une exposition prolongée et répétée avec l’agent stressant et donc un mode « alerte » activé en continu.
Les hormones sont sécrétées sans interruption, sans repos pouvant mener à l’épuisement de l’organisme, impactant fortement la bonne santé
Les répercutions sont multiples:
- Émotionnel
- Comportemental
- Cognitif
- Déprime
- Agressivité constante
- Fatigue émotionnelle
- Enervement
- Difficulté de concentration
- Troubles de la mémoire
- Anxiété exacerbée
- Emotivité
- Agitation
- Sommeil perturbé.
Stress modéré mais répété
Les événements de la vie se rapprochent plus souvent d’une agressions modérées mais répétées que d’une agressions intenses et uniques.
Dans ce cas, l’amplitude du stress et sa rapidité d’activation se modulent dans le temps, soit en réduction (habituation), soit en augmentation (sensibilisation).
Il est suivi d’un allongement de la durée du sommeil (rebond de sommeil) via l’augmentation des taux de glucocorticoïdes. Inversement, un stress intense est suivi d’une insomnie relative.
Étapes de l’Évolution du Stress : Positive (Adaptation) et Négative (Épuisement)
La qualité du stress réside dans l’équilibre entre son efficacité et son économie.
Un stress « ajusté » (eustress), répondant précisément à la menace et s’éteignant lorsque celle-
- L’eustress est suivi d’une augmentation de la durée du sommeil (rebond)
Quand il est ajusté mais intense, l’organisme développe des stratégies comportementales visant à réduire l’impact cellulaire du stress.
Inversement, un stress « non ajusté » (distress) est dissocié de l’agression (trop court ou trop long, excessif ou insuffisant) et associé, à des degrés divers, a un découplage entre les activations des axes corticotrope et autonome.
- Le distress s’accompagne d’une réduction du temps de sommeil
Le stress est la réaction biologique d’un organisme exposé à un changement significatif de son environnement.
L’organisme entre en « état d’alerte », et déclenche une véritable tempête hormonale avec une activation corticotrope insuffisante s’accompagne d’un excès d’activation catécholaminergique.
L’adaptation se fait en quatre phases
Une phase d’alarme durant laquelle l’organisme mobilise toutes ses ressources grâce à une régulation entraînant une augmentation constante de la réponse.
La capacité d’adaptation à la situation stressante est intimement liée à la personne, son expérience, sa mémoire, son état de santé, sa perception de la situation.
Une phase de résistance durant laquelle l’organisme ajuste sa réponse au strict besoin grâce à une régulation permettant une stabilité de la réponse.
Une phase de récupération si le stresseur disparaît les mécanismes de récupération permettent d’effacer le coût biologique en reconstituant les stocks d’énergie et des composés spécifiques, en éliminant les déchets et en régénérant la structure cellulaire de l’organisme.
Le système nerveux autonome, parasympathique ou vagal interviennent
Après exposition à un stress intense ou à une répétition de stress de moindre intensité, il peut persister un stress résiduel de bas niveau. L’organisme fonctionne en continu d’une manière excessive, avec une balance catabolisme/anabolisme déséquilibrée vers le catabolisme : l’organisme est en allostasie.
Une phase parfois d’épuisement. Qui peut se traduire par l’émergence de maladies, voire de décès. L’épuisement entraîne des maladies cardiaques, une pression artérielle constamment élevée, des taux de cholestérol augmentés, du diabète, des ulcères à l’estomac, une diminution des défenses immunitaires etc.
Conséquences Négatives du Stress sur la Santé
Stress et travail
- Un salarié sur quatre est aujourd’hui trop stressé au travail.
- Les individus souffrant d'une maladie cardiométabolique et de stress au travail présentent un risque de mortalité beaucoup plus élevé que ceux qui travaillent sereinement
- Les femmes atteintes d’une maladie cardiométabolique associée à un stress au travail décèdent à 53,2 ans en moyenne, contre 64 ans pour celles qui travaillaient dans de bonnes conditions.
- Un salarié sur quatre est en situation d’hyperstress au travail. Les femmes seraient davantage concernées que les hommes.
Stress et personnes jeunes
- À l’adolescence, une mauvaise gestion du stress peut se faire ressentir sur le long terme :
- 20% des jeunes participants les plus stressés avaient 50% de risques en plus de développer un diabète de type 2.
- Une mauvaise résistance au stress chez les jeunes adultes a également été associée à des troubles cognitifs plus importants 25 ans après. (Le terme "déclin cognitif" englobe des maladies comme Alzheimer ou Parkinson.)
- Le stress est "un facteur important dans le déclenchement et l’entretien d’une poussée d’acné", en effet les médiateurs chimiques (substance P et corticolibérine) sont connus pour aggraver les maladies cutanées présentant une composante inflammatoire : psoriasis, eczéma atopique, herpès…
Stress et cancer
Les taux de mortalité dans le groupe le plus stressé sont augmenté pour toute personne souffrant de cancers
Stress et maladies cardio vasculaire
Une hausse de stress est associée à un risque 1,6 fois plus élevé d’incident cardiovasculaire.
Stress et autres accidents de santé
- Les personnes atteintes du TSPT (trouble de stress post-
traumatique) sont 46% plus susceptibles de développer une des 41 maladies auto- immunes existantes, et plus de deux fois plus susceptibles de développer au moins trois troubles auto- immuns. - Il existe un lien étroit entre le stress et la dépression.
- Un stress psychologique au cours de sa vie peut augmenter de 42% le risque de fausse couche.
Stress et modification anatomique et physiologique du cerveau
- Le stress se traduit par des modifications structurelles et organisationnelles du cerveau qui peuvent être transitoires ou définitives
- Une hyperactivité de l'amygdale peut entraîner une mémorisation excessive des expériences négatives, ce qui peut contribuer au développement de troubles anxieux tels que le trouble de stress post-
traumatique (TSPT). - Elle inter agit avec d'autres régions du cerveau, notamment le cortex préfrontal qui permet de moduler les réactions émotionnelles et d'adapter le comportement en fonction du contexte.
- L’atrophie de l’hippocampe est observée chez les patients victimes de TSPT, et plus généralement lors de toutes pathologies du au stress.
- L’exposition à des stress chroniques ou répétés peut s’accompagner de réductions des taux circulants et tissulaires de neurotrophines, entraînant une moindre élimination des radicaux libres et pouvant participer à la constitution des pathologies mentales comme la dépression.
- Le stress est également suivi de la mobilisation des cellules cérébrales souches à partir des niches hippocampiques. Ces cellules souches interviennent dans la restructuration du cerveau en créant de nouvelles connexions cérébrales, participant à la prévention des maladies mentales après l’exposition à un stress intense.
Stratégies de Gestion et d’Évolution Positive du Stress
Conséquences possible du stress : Fuite, Lutte, Inhibition.
La meilleure attitude réside surtout dans l’action.
- L’activité va permettre de détourner l’agressivité, la frustration. L’activité peut être physique ou psychique.
- Essayer de trouver une activité « canalisatrice de stress » correspondant à chaque agent stressant.
- L’exercice physique facilite l’expression de facteur trophique et module l’expression du génome par une action sur sa régulation épigénétique.
- Il est essentiel d’apprendre à gérer son stress en sachant écouter son corps et son psychisme pour détecter les premiers signes des effets néfastes du stress
- En apprenant à reconnaître les agents stressants qui nous entourent (perception individuelle), et en comprenant nos réactions face aux agents stressants.
- La respiration profonde qui apporte une oxygénation et stimule le système parasympathique réduit le rythme cardiaque et favorise l’apaisement
- Le stress ne disparaîtra peut-
être jamais complètement, mais nous pouvons apprendre à le transformer en une force motrice plutôt qu’en un obstacle. - La réduction des apports énergétiques, ou toute autre méthode de réduction d’une masse pondérale, réduit l’inflammation.
- C’est la succession de stress suivis de récupérations plus ou moins complètes qui importe à l’aune d’une vie.
Le phénomène de résilience se traduit par un retour à un état quo ante à la suite du premier stress.
Autres Aspects du Stress
Le mot « stress » est introduit en médecine en 1936 par le Docteur Hans Selye.
Contagiositè du stress !
L'activation de l'hormone ACTH provoque la libération d'un signal chimique dans le cerveau de la souris, qui va alerter les partenaires
Les hormones ACTH des partenaires, qui n'étaient pas eux-
Les variations du niveau de cette hormone ont été observées chez 211 individus à qui on avait demandé de regarder une personne confrontée à un stress psychologique. Une sur quatre a vu son niveau de stress augmenter
La valeur accordée aux informations perçues (valence) ainsi que le sentiment de maîtrise expliquent la différence entre l’intensité du stress perçu par l’individu et l’agressivité réelle du stresseur.
RÉSUMÉ
- Le stress est une réaction biologique à un changement environnemental, de causes variées (travail, argent, etc.) et des mécanismes physiologiques complexes impliquant le cerveau (amygdale, hypothalamus), le système nerveux (sympathique et parasympathique), et des hormones (cortisol, adrénaline, etc.) ainsi que des neurotransmetteurs.
- Il peut être aigu (mobilisateur) ou chronique (affaiblissant), et se déroule en phases d'alarme, de résistance et potentiellement d'épuisement.
- Un stress non géré ou chronique est lié à de nombreuses maladies (cardiovasculaires, auto-
immunes, cancers, troubles cognitifs, etc.). - La gestion du stress passe par la reconnaissance des stresseurs, l'écoute du corps, l'activité physique ou psychique, et la respiration.
- L'organisme possède des mécanismes d'adaptation et de récupération, mais une exposition répétée ou intense peut entraîner un stress résiduel, des déséquilibres cellulaires (inflammation, radicaux libres, dysfonction mitochondriale) et une vulnérabilité accrue face à de futurs autres situations stressantes
- La compréhension et la gestion du stress sont cruciales pour la santé à long terme.
L'effet placebo, un phénomène fascinant et complexe, met en lumière la puissante interaction entre l'esprit et le corps dans le domaine de la santé. Le terme "placebo", dérivé du latin signifiant "je plairai", désigne initialement une substance inerte, dépourvue de tout principe pharmacologique actif. Pourtant, l'"effet placebo" transcende cette simple définition, englobant une réalité biologique tangible et souvent étonnamment puissante.
Au cœur de la recherche médicale, toute nouvelle molécule thérapeutique est rigoureusement évaluée "contre placebo". Dans ces essais cliniques, un groupe de patients reçoit le médicament actif tandis qu'un groupe témoin se voit administrer un placebo, sans qu'aucun des participants, ni les expérimentateurs ne connaissent la nature de ce qu'il reçoit. La comparaison des effets observés permet de déterminer l'efficacité réelle du traitement au-
Loin d'être une simple illusion, l'effet placebo se manifeste par des changements physiologiques mesurables et quantifiables.
Son impact est particulièrement remarquable dans la gestion de la douleur, où des patients recevant un placebo peuvent expérimenter une atténuation de leur souffrance comparable à celle observée chez des individus ayant subi une intervention chirurgicale réelle.
Mais les applications de l'effet placebo s'étendent bien au-
Il est crucial de noter, cependant, que l'effet placebo ne saurait guérir des maladies graves comme le cancer.
L'effet placebo n'est pas uniforme et peut même se manifester de manière négative, un phénomène connu sous le nom d'"effet nocebo". Ainsi, l'attente anxieuse d'effets secondaires peut paradoxalement conduire à leur apparition.
De manière surprenante, même la connaissance de prendre un placebo ne semble pas toujours annuler son effet. Inversement, administré à l'insu du patient, le placebo perd son pouvoir.
Les mécanismes sous-
L'imagerie cérébrale a permis d'identifier les zones clés impliquées, notamment une baisse d'activité dans le thalamus, le cortex somatosensoriel, l'insula antérieure et le cortex cingulaire antérieur, régions impliquées dans la perception de la douleur. Simultanément, on observe une activation du cortex préfrontal (impliqué dans l'attente et la prise de décision), de l'amygdale (émotions) et du noyau accumbens (motivation et récompense). Chez les patients atteints de la maladie d'Alzheimer, dont le cortex préfrontal est lésé, l'effet placebo se révèle souvent inaccessible, soulignant le rôle crucial de l'attente.
Le contexte entourant l'administration d'un traitement joue un rôle primordial dans le déclenchement de l'effet placebo. Du packaging à la couleur des pilules (le blanc étant souvent associé au soulagement de la douleur, le rouge à la stimulation et le bleu à l'apaisement), chaque détail peut influencer l'efficacité perçue. L'organisme semble développer un certain conditionnement en réponse à des signaux associés à la prise de médicaments.
Face au placebo, nous ne sommes pas tous égaux. Des études suggèrent que les "placebo répondeurs" pourraient présenter une plus grande connectivité dans le cortex préfrontal, en particulier dans le gyrus frontal médian droit. Des facteurs psychologiques tels que l'optimisme, la suggestibilité et l'empathie sont également associés à une meilleure réponse. Inversement, le pessimisme et l'anxiété peuvent favoriser l'effet nocebo. La recherche explore même l'existence d'un "placebome", un ensemble de particularités génétiques qui pourraient prédisposer à une meilleure réponse placebo.
L'effet placebo partage des mécanismes neuronaux communs avec d'autres approches telles que l'hypnose et la méditation, impliquant notamment le cortex préfrontal, l'amygdale et le cortex cingulaire.
La reconnaissance de la puissance de l'effet placebo ouvre des perspectives intéressantes pour la pratique médicale.
Certains envisagent la possibilité de prescrire ouvertement des placebos, en s'appuyant sur le conditionnement de l'organisme. Le concept de "placebo par prolongement de dose", où l'on substitue progressivement le médicament actif par un placebo, est également exploré. Des études ont montré que même en informant les patients qu'ils reçoivent un placebo, une proportion significative d'entre eux rapporte une amélioration de leurs symptômes.
Il est essentiel de noter que l'effet placebo représente une part non négligeable de l'efficacité des médicaments et des soins en général.
- Les paroles du soignant
- L’instauration d'une relation de confiance
- L'attention portée au patient
- La suggestion
Sont de puissants leviers pour amplifier cet effet.
Paradoxalement, des phrases rassurantes mal formulées peuvent parfois avoir l'effet inverse, augmentant la douleur et l'anxiété.
La propre conviction du thérapeute quant à l'efficacité du traitement, même s'il s'agit d'un placebo, semble également influencer l'état du patient.
Comprendre et exploiter l'effet placebo de manière éthique pourrait permettre de réduire la dépendance aux traitements pharmacologiques et d'améliorer la prise en charge des patients en tirant parti des capacités d'autoguérison de l'organisme.
Résumé
L'effet placebo est un phénomène réel et puissant où une substance inerte ou un traitement sans action pharmacologique produit un effet bénéfique sur la santé d'un individu en raison de ses attentes, de son conditionnement et du contexte de soin.
Il active des réseaux neuronaux spécifiques et libère des neurotransmetteurs comme les endorphines, influençant notamment la perception de la douleur, les performances cognitives et les symptômes de certaines maladies.
L'efficacité du placebo est modulée par des facteurs psychologiques, génétiques potentiels et par l'environnement du traitement, y compris la relation patient-
La recherche explore activement les moyens d'intégrer l'effet placebo de manière éthique dans la pratique clinique pour optimiser les soins et potentiellement réduire la prescription de médicaments.
Les émotions sont des réactions physiologiques plus ou moins intenses avec des connotations positives et négative, sagit-
Stress et Émotions
Des Mécanismes Entrecroisés aux Impacts Distincts sur la Santé
Les émotions, (positives ou négatives) et le stress partagent des bases physiologiques communes mais se distinguent par leurs répercussions sur l'organisme, notamment au niveau hormonal. Si le stress est majoritairement perçu comme négatif, les émotions positives semblent emprunter des voies spécifiques bénéfiques pour la santé.
Difficile d’établir une liste des émotions
Une classification pourrait considérer qu’il n’existe que quelques émotions fondamentales et
Que l’association de deux provoque des émotions secondaires
Mécanismes Communs et Spécificités
Toute émotion est une réaction complexe qui englobe une
- Expérience subjective
- Une réponse physiologique (comme l'accélération du rythme cardiaque ou la détente musculaire)
- Une interprétation cognitive.
Des structures cérébrales clés telles que l'amygdale, impliquée dans la gestion de la peur et de la menace, et l'hippocampe, lié à la mémoire émotionnelle, jouent un rôle central.
Des neurotransmetteurs comme la dopamine (associée au plaisir), la sérotonine (régulation de l'humeur) et la noradrénaline modulent ces états.
Le stress, quant à lui, est classiquement décrit par le "syndrome général d'adaptation" qui se déroule en trois phases :
1. Phase d'alarme : L'organisme réagit immédiatement à un stresseur par la libération d'hormones comme l'adrénaline (une catécholamine). Cela prépare le corps à une réaction de "combat ou de fuite", augmentant la fréquence cardiaque et la vigilance.
2. Phase de résistance : Si le stresseur persiste, le corps sécrète des glucocorticoïdes, notamment le cortisol. Ces hormones aident à maintenir un niveau d'énergie élevé pour faire face à la situation.
3. Phase d'épuisement : Une exposition prolongée au stress sans résolution conduit à l'épuisement des ressources de l'organisme, pouvant entraîner des effets néfastes sur la santé.
L'amygdale est également impliquée dans le décodage des émotions liées au stress. Ainsi, le stress partage des voies physiologiques avec les émotions, en particulier les émotions négatives, par l'activation de l'amygdale et la production d'adrénaline et de cortisol.
La Voie des Émotions Positives : Un Bouclier pour la Santé ?
Les émotions positives, telles que la joie ou la gratitude, bien qu'impliquant le système émotionnel général, semblent activer des circuits neuro-
1 La dopamine : Souvent appelée "l'hormone du plaisir", elle est impliquée dans le système de récompense du cerveau.
2 La sérotonine : Contribue au bien-
3 Les endorphines : Produites notamment lors de l'activité physique, elles ont des propriétés analgésiques et procurent une sensation de bien-
4 L'ocytocine : Parfois surnommée "l'hormone de l'amour" ou "l'hormone du lien social", elle est libérée lors d'interactions sociales positives et contribue à réduire le stress et l'anxiété.
Ces substances peuvent activement contrecarrer les effets délétères du stress. Par exemple, l'activité physique, source d'émotions positives, stimule non seulement les endorphines et la dopamine, mais peut aussi aider à réguler le taux de cortisol.
Le Stress : Une Émotion Négative Particulière
Le stress est donc intimement lié aux émotions négatives comme l'anxiété ou la peur, partageant avec elles certaines voies de réponse de l'organisme, notamment la production accrue de cortisol. Le stress chronique maintien des niveaux élevés de cortisol, ce qui peut entraîner des conséquences délétères à long terme : affaiblissement du système immunitaire, augmentation du risque de maladies cardiovasculaires, troubles de l'humeur (dépression, anxiété).
Une baisse de dopamine et de sérotonine peut également être une conséquence d'un stress accru.
En conclusion
Si le stress emprunte en partie les mêmes mécanismes que les émotions, notamment négatives, avec une forte connotation hormonale (adrénaline, cortisol) préparant à une réaction intense, il existe bien des mécanismes spécifiques plus favorables à la santé pour les émotions positives.
Ces dernières impliquent la libération d'un cocktail hormonal (dopamine, sérotonine, endorphines, ocytocine) qui peut non seulement procurer un sentiment de bien-
|
|
JOIE |
TRISTESSE |
DÉGOÛTS |
PEUR |
COLÈRE |
|
JOIE |
EXTASE EUPHORIE |
MELANCOLIE NOSTALGIE |
OBSESSION INTRIGUE |
SURPRISE |
FÉROCITÉ JUSTICE |
|
TRISTESSE |
MÉLANCOLIE NOSTALGIE |
DÉSESPOIR |
DÉPRESSION AMERTUME |
ANXIÉTÉ |
TRAHISON FRUSTRATION |
|
DÉGOÛT |
OBSESSION INTRIGUE |
DÉPRESSION AMERTUME |
MÉPRIS REJET |
RÉVULSION HONTE |
AVERSION MÉPRIS |
|
PEUR |
SURPRISE |
ANXIÉTÉ |
RÉVULSION HONTE |
TERREUR |
HAINE |
|
COLÈRE |
FÉROCITÉ JUSTICE |
TRAHISON FRUSTRATION |
AVERSION MEPRIS |
HAINE |
RAGE |
Le corps humain est constamment exposé à des molécules instables appelées radicaux libres. Ces molécules, qui possèdent un électron célibataire, sont très réactives et cherchent à se stabiliser en "volant" un électron à d'autres molécules du corps, comme l'ADN, les protéines et les lipides. Ce processus, appelé stress oxydatif, peut entraîner des dommages cellulaires, un vieillissement prématuré et un risque accru de diverses maladies.
C'est là qu'interviennent les antioxydants. Leur rôle principal est de neutraliser les radicaux libres en leur cédant un électron, stabilisant ainsi ces molécules avant qu'elles ne puissent causer des dommages. Les antioxydants agissent comme des "pièges à radicaux libres".
Mécanismes d'action des antioxydants :
- Il existe deux grandes catégories d'antioxydants dans l'organisme :
- Antioxydants endogènes (produits par le corps) :
- Enzymes antioxydantes : Ce sont les premières lignes de défense de l'organisme. Elles ont pour rôle de transformer les radicaux libres en molécules inoffensives. Les principales enzymes antioxydantes sont :
- Superoxyde dismutase (SOD) : Catalyse la dismutation des ions superoxyde (O2•-
) en peroxyde d'hydrogène (H2O2). Elle nécessite des cofacteurs comme le cuivre, le zinc et le manganèse. - Catalase : Transforme le peroxyde d'hydrogène (H2O2) en eau et oxygène. On la trouve notamment dans le foie, les reins et les globules rouges.
- Glutathion peroxydase (GPx) : Réduit les hydroperoxydes en utilisant le glutathion. Elle est une sélénoprotéine, ce qui signifie qu'elle contient du sélénium.
- Molécules non-
enzymatiques : Le corps produit également des molécules qui agissent directement en piégeant les radicaux libres, telles que : - Glutathion : Un tripeptide puissant qui joue un rôle central dans la détoxification et la défense antioxydante.
- Coenzyme Q10 (Ubiquinone) : Essentiel à la production d'énergie cellulaire dans les mitochondries et agissant comme un antioxydant liposoluble.
- Acide urique : Un antioxydant important dans le plasma sanguin.
- Albumine : Une protéine plasmatique qui peut l'ier et neutraliser certains radicaux libres.
- Antioxydants exogènes (apportés par l'alimentation) :
- Ces antioxydants sont essentiels pour compléter les défenses endogènes, surtout lorsque le stress oxydatif est élevé ou que la production endogène diminue (avec l'âge par exemple). Ils comprennent principalement :
- Vitamines antioxydantes :
- Vitamine C (acide ascorbique) : Hydrosoluble, elle agit dans les milieux aqueux (cytoplasme, sang) et peut régénérer la vitamine E.
- Vitamine E (tocophérols et tocotriénols) : Liposoluble, elle protège les membranes cellulaires (riches en lipides) de la peroxydation.
- Vitamine A et ses précurseurs (caroténoïdes comme le bêta-
carotène) : Liposolubles, ils jouent un rôle protecteur, notamment au niveau des membranes. - Polyphénols :
- Une vaste famille de composés végétaux aux propriétés antioxydantes et anti-
inflammatoires (flavonoïdes, anthocyanes, tanins, resvératrol...). - Minéraux et oligo-
éléments : - Bien qu'ils ne soient pas des antioxydants à proprement parler, ils sont des cofacteurs essentiels pour l'activité des enzymes antioxydantes (sélénium, zinc, cuivre, manganèse).
Rôle des antioxydants par organe et fonction :
Les antioxydants sont cruciaux pour la santé de l'ensemble de l'organisme, protégeant les cellules et les tissus des dommages oxydatifs.
- Cerveau :
- Est particulièrement vulnérable au stress oxydatif en raison de sa forte consommation d'oxygène et de sa richesse en lipides (neurones). Les antioxydants protègent les neurones, préviennent les dommages à l'ADN et aux protéines, et peuvent aider à maintenir les fonctions cognitives.
- La vitamine E, la vitamine C, les polyphénols (flavonoïdes) peuvent traverser la barrière hémato-
encéphalique. L'astaxanthine est connue pour sa capacité à pénétrer le cerveau et l'œil. - Yeux :
- Sont exposés à la lumière UV et à une forte activité métabolique, générant des radicaux libres. Les antioxydants protègent la rétine et le cristallin, prévenant des maladies comme la dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA) et la cataracte.
- La lutéine et la zéaxanthine (caroténoïdes) s'accumulent dans la macula. La vitamine C et la vitamine E sont également importantes.
- Peau :
- Est en première ligne face aux agressions extérieures (rayons UV, pollution) qui gênèrent des radicaux libres. Les antioxydants protègent les cellules cutanées, le collagène et l'élastine, aidant à prévenir le vieillissement prématuré (rides, perte de fermeté) et les dommages liés au soleil, y compris le risque de cancer cutané.
- Vitamine C, vitamine E, bêta-
carotène, polyphénols. - Système Cardiovasculaire :
- Le stress oxydatif joue un rôle dans le développement de l'athérosclérose (durcissement des artères) en oxydant le cholestérol LDL et en endommageant les parois des vaisseaux sanguins. Les antioxydants aident à maintenir l'intégrité des vaisseaux, à réduire l'inflammation et à prévenir l'oxydation des lipides.
- Vitamine E, polyphénols (notamment ceux du thé vert et du vin rouge), coenzyme Q10.
- Système Immunitaire :
- Les cellules immunitaires produisent des radicaux libres pour combattre les agents pathogènes, mais un excès peut également les endommager. Les antioxydants aident à équilibrer cette production, protégeant les cellules immunitaires et soutenant leur bon fonctionnement.
- Vitamine C, vitamine E, zinc, sélénium.
- Foie :
- Est un organe majeur de détoxification et est donc fortement exposé aux radicaux libres générés lors de ces processus. Les antioxydants soutiennent sa capacité à éliminer les toxines et à se protéger des dommages.
- Glutathion, vitamine C, vitamine E.
- Articulations :
- Le stress oxydatif peut contribuer à l'inflammation chronique et à la dégradation du cartilage dans des affections comme l'arthrite. Les antioxydants aident à réduire l'inflammation et à protéger les tissus articulaires.
- Vitamine C, polyphénols (curcumine).
- ADN :
- Les radicaux libres peuvent directement endommager l'ADN, entraînant des mutations et un risque accru de cancer. Les antioxydants aident à protéger l'intégrité du matériel génétique.
- Toutes les enzymes antioxydantes, vitamines C et E, polyphénols.
Principaux antioxydants et leurs sources :
Voici une liste des antioxydants les plus importants et où les trouver dans votre alimentation :
- Vitamine C (acide ascorbique) :
- Sources : Cassis, agrumes (orange, pamplemousse, citron), kiwis, fraises, poivrons rouges, brocolis, choux de Bruxelles, persil.
- Vitamine E (tocophérols et tocotriénols) :
- Sources : Huiles végétales (germes de blé, tournesol, colza, olive), oléagineux (amandes, noisettes, noix), graines (tournesol), avocats, épinards.
- Vitamine A et Caroténoïdes (bêta-
carotène, lycopène, lutéine, zéaxanthine) : - Sources :Bêta-
carotène (provitamine A) : Carottes, patates douces, potimarron, mangue, abricots, légumes verts foncés (épinards, brocolis, chou frisé). Sources du lycopène : Tomates (surtout cuites), pastèque, pamplemousse rose. Soures de la Lutéine et la Zéaxanthine : Épinards, chou frisé, maïs, brocolis, œufs (jaune). - Polyphénols (Flavonoïdes, Anthocyanes, Resvératrol, etc.) :
- Sources : Fruits rouges et violets : Baies (myrtilles, framboises, cassis, mûres), cerises, raisins, prunes. Légumes : Oignons, brocolis, épinards, artichauts, choux. Thé vert, café, cacao/chocolat noir, vin rouge. Curcuma (curcumine), cannelle, gingembre.
- Sélénium :
- Sources : Noix du Brésil, fruits de mer (thon, crevettes), viandes (bœuf, poulet), œufs, céréales complètes.
- Zinc :
- Sources : Huîtres, viande rouge, germes de blé, légumineuses (lentilles, haricots secs), graines de courge.
- Coenzyme Q10 (CoQ10) :
- Sources : Viandes (bœuf, poulet), poissons gras (sardines, maquereaux), épinards, brocolis, céréales complètes.
- Acide alpha-
lipoïque : - Sources : Épinards, brocolis, rognons, cœur, viande rouge.
- Glutathion :
- Sources : Bien que le corps le synthétise, certains aliments peuvent favoriser sa production ou en contenir de petites quantités : asperges, avocats, épinards, brocolis, chou de Bruxelles.
En résumé, les antioxydants sont des gardiens essentiels de notre santé cellulaire, protégeant notre organisme des dommages causés par les radicaux libres. Une alimentation variée et riche en fruits, légumes, céréales complètes et sources de protéines de qualité est la meilleure stratégie pour assurer un apport suffisant en ces précieux protecteurs.
Rappel
L'oxydation et l'inflammation sont des processus distincts dans l'organisme, bien qu'ils soient étroitement liés et puissent s'influencer mutuellement, menant souvent à des conséquences communes.
LO’xydation (Stress Oxydatif) est un déséquilibre entre la production de radicaux libres (molécules instables très réactives) et la capacité du corps à les neutraliser via les antioxydants. Les radicaux libres tentent de se stabiliser en "volant" des électrons à d'autres molécules (ADN, protéines, lipides), ce qui les endommage, c’est un processus métaboliques normal (respiration cellulaire), ou par exposition à des toxines (pollution, tabac), rayons UV, stress, alimentation déséquilibrée, etc, ce qui entraînes des dommages cellulaires, des altération de l'ADN, une peroxydation lipidique (dommage aux membranes cellulaires), une dénaturation des protéines.
- Les antioxydants neutralise les radicaux libres pour prévenir ces dommages.
- L'inflammation est une réponse complexe du système immunitaire à une blessure, une infection, une irritation ou des dommages cellulaires. C'est un mécanisme de défense essentiel visant à éliminer l'agent nocif, à nettoyer les débris et à initier le processus de réparation des tissus.
- Cliniquement on constate la triade classique: Rougeur, chaleur, douleur, mais aussi gonflement et parfois perte de fonction (rubor, calor, tumor, dolor, functio laesa).
- Les Causes : Agents pathogènes (bactéries, virus), blessures physiques, produits chimiques irritants, réactions auto-
immunes. - Conséquences directes : Afflux de cellules immunitaires, libération de médiateurs inflammatoires (cytokines, prostaglandines), dilatation des vaisseaux sanguins, augmentation de la perméabilité vasculaire.
- Rôle des anti-
inflammatoires : Moduler cette réponse pour éviter qu'elle ne devienne excessive ou chronique, ce qui pourrait causer des dommages aux tissus sains.
Lien entre Oxydation et Inflammation :
Ces deux processus sont fortement intriqués :
- L'oxydation peut provoquer l'inflammation : Les dommages cellulaires causés par le stress oxydatif peuvent être perçus par l'organisme comme une menace, déclenchant ainsi une réponse inflammatoire. Par exemple, l'oxydation des lipides (comme le LDL-
cholestérol) est un facteur clé dans le développement de l'inflammation des parois artérielles dans l'athérosclérose. - L'inflammation peut générer de l'oxydation : Les cellules immunitaires impliquées dans la réponse inflammatoire (comme les macrophages et les neutrophiles) produisent intentionnellement des radicaux libres (appelés "éclatement oxydatif") pour tuer les pathogènes. Cependant, cette production peut être excessive et endommager les tissus environnants, créant ainsi un stress oxydatif secondaire qui alimente l'inflammation.
- Le cycle est vicieux si non contrôlés, le stress oxydatif entretient l'inflammation chronique, et l'inflammation chronique génére davantage de stress oxydatif, contribuant à de nombreuses maladies chroniques (maladies cardiovasculaires, diabète, maladies neurodégénératives, certains cancers, maladies auto-
immunes). - Conséquences :
Les conséquences à long terme de l'oxydation chronique et de l'inflammation chronique sont en effet similaires et souvent superposées :
- Vieillissement accéléré : Dommages aux cellules et aux tissus.
- Maladies cardiovasculaires : Athérosclérose, hypertension.
- Maladies neurodégénératives : Alzheimer, Parkinson.
- Cancers : Dommages à l'ADN et promotion de la croissance cellulaire anormale.
- Maladies métaboliques : Résistance à l'insuline, diabète de type 2.
- Maladies auto-
immunes et inflammatoires : Polyarthrite rhumatoïde, maladies inflammatoires de l'intestin.
Les Anti-
Il existe de nombreux composés naturels qui possèdent des propriétés anti-
Voici quelques-
- Oméga-
3 (Acides Gras Polyinsaturés) : Ils sont métabolisés en molécules (résolvines, protectines, marésines) qui ont un rôle actif dans la résolution de l'inflammation. Ils peuvent également inhiber la production de médiateurs inflammatoires (comme les prostaglandines pro- inflammatoires). - Présentes dans les poissons gras (saumon, maquereau, sardine, anchois), l’huile de lin, les graines de chia, les noix.
- Curcumine (composé actif du Curcuma) La curcumine est un puissant anti-
inflammatoire qui agit sur de multiples voies de l'inflammation, notamment en inhibant le facteur nucléaire NF- κB, une protéine clé qui active la production de nombreuses molécules pro- inflammatoires. - Présente essentiellement dans le Curcuma (épice). L'absorption est améliorée avec la pipérine (poivre noir).
- Quercétine (Flavonoïde) : Un antioxydant puissant qui peut inhiber la libération d'histamine (impliquée dans les réactions allergiques et inflammatoires) et la production de plusieurs cytokines pro-
inflammatoires. - Il faut consommer des oignons, des pommes, des baies (myrtilles, framboises), des câpres, thé vert et brocoli.
- Resvératrol (Polyphénol) : Qui peut inhiber les enzymes COX (cyclooxygénases) et LOX (lipoxygénases), impliquées dans la production de médiateurs inflammatoires, agissant également sur NF-
κB. - Les raisins rouges, le vin rouge, les baies et les cacahuètes en sont riche
- Bromélaïne (Enzyme de l'Ananas) : Mélange d'enzymes protéolytiques qui peut aider à réduire le gonflement et la douleur en influençant la production de prostaglandines et en décomposant les complexes immuns.
- Dans l’ananas (surtout la tige) bien sur
- Gingérols (composés actifs du Gingembre) : Les gingérols et shogaols du gingembre ont des propriétés anti-
inflammatoires similaires à celles des AINS, en inhibant la production de prostaglandines et de leucotriènes. - Catéchines (du Thé Vert) : L'EGCG (épigallocatéchine gallate), la catéchine la plus abondante dans le thé vert, possède des propriétés anti-
inflammatoires en modulant diverses voies de signalisation impliquées dans l'inflammation. - Capsaïcine (composé actif du Piment) : Réduit une substance appelée Substance P, impliquée dans la transmission de la douleur et l'inflammation neurogène.
- Arnica montana (usage topique ou homéopathique) : Contient des lactones sesquiterpéniques avec des propriétés anti-
inflammatoires. Utilisée traditionnellement pour réduire les ecchymoses, le gonflement et la douleur liés aux traumatismes. - Dans la plante (usage externe ou homéopathique, non pour consommation interne directe).
- Griffe du diable (Harpagophytum procumbens) : Contient des harpagosides qui ont montré une capacité à inhiber les médiateurs de l'inflammation (cytokines).
- On le trouve dans la racine de la plante
En conclusion
L'oxydation et l'inflammation sont des processus distincts mais interconnectés qui peuvent tous deux entraîner des dommages cellulaires et contribuer au développement de maladies chroniques. Si les antioxydants ciblent spécifiquement la neutralisation des radicaux libres, il existe bel et bien une multitude de composés naturels aux propriétés anti-
Les radicaux libres sont des molécules ou des atomes qui possèdent au moins un électron non apparié sur leur couche externe. Cette particularité les rend extrêmement instables et très réactifs. Pour retrouver leur stabilité, ils vont chercher à "voler" un électron à d'autres molécules stables du corps (lipides, protéines, ADN), les endommageant au passage. Ce processus est appelé oxydation.
L'accumulation de ces dommages due à un excès de radicaux libres et/ou un déficit en antioxydants est ce que l'on appelle le stress oxydatif.
Les radicaux libres proviennent de deux sources principales :
- Sources Endogènes (produits par le corps lui-
même) : - C’est le métabolisme cellulaire normal, a principale source est la respiration cellulaire, le processus par lequel nos cellules produisent de l'énergie (ATP) à partir de l'oxygène et des nutriments dans les mitochondries. Environ 1 à 2% de l'oxygène consommé par nos cellules est converti en radicaux libres.
- Les cellules immunitaires (comme les macrophages et les neutrophiles) produisent intentionnellement des radicaux libres (appelé "éclatement oxydatif") pour tuer les bactéries, virus et autres agents pathogènes. C'est un mécanisme de défense essentiel.
- L'inflammation elle-
même peut générer des radicaux libres, car les cellules immunitaires actives dans les zones inflammatoires en produisent pour accomplir leur tâche. - Exercice physique intense : Un exercice très intense peut temporairement augmenter la production de radicaux libres en raison de l'augmentation du métabolisme de l'oxygène.
- Sources Exogènes (provenant de l'environnement extérieur) :
- Pollution atmosphérique : Particules fines, ozone, oxydes d'azote, etc.
- Rayonnement UV : Principalement les UVA et UVB du soleil.
- Rayonnements ionisants : Rayons X, radiothérapie.
- Tabagisme : La fumée de cigarette est une source majeure de milliers de substances chimiques, dont de nombreux radicaux libres et pro-
oxydants. - Alcool : Sa métabolisation génère des radicaux libres.
- Médicaments : Certains médicaments peuvent augmenter la production de radicaux libres comme effet secondaire.
- Certains pesticides et produits chimiques industriels.
- Aliments transformés et cuisson excessive : La friture, les aliments grillés/carbonisés à haute température peuvent former des composés pro-
oxydants. - Stress psychologique chronique : Peut indirectement augmenter la production de radicaux libres via la libération d'hormones de stress.
Les Radicaux Libres : Conséquence de nos "mauvaises habitudes" ?
Oui, en grande partie ! Si une certaine production de radicaux libres est inévitable et même nécessaire pour certaines fonctions biologiques, une production excessive est très souvent la conséquence de nos habitudes de vie :
- Mauvaises habitudes comportementales :
- Tabagisme : La cause la plus significative et évitable.
- Exposition excessive au soleil : Sans protection.
- Manque de sommeil : Peut perturber les processus de réparation cellulaire.
- Stress chronique : Affecte le système hormonal et immunitaire, pouvant augmenter l'oxydation.
- Sédentarité ou exercice excessif non contrôlé : Bien que l'exercice modéré soit protecteur, un surentraînement peut générer un stress oxydatif.
- Mauvaises habitudes alimentaires :
- Aliments transformés, riches en sucres raffinés, graisses trans et saturées : Ces aliments peuvent promouvoir l'inflammation et le stress oxydatif.
- Manque de fruits et légumes : Ces aliments sont les principales sources d'antioxydants alimentaires. Une carence signifie moins de défense contre les radicaux libres.
- Consommation excessive d'alcool.
- Cuisson à haute température : Friture, aliments carbonisés.
En résumé
Si les radicaux libres sont naturellement produits par notre corps, nos modes de vie modernes, avec la pollution, le tabac, l'alimentation déséquilibrée et le stress, augmentent considérablement leur production et/ou diminuent nos défenses, menant à un déséquilibre et à un stress oxydatif néfaste.
Antioxydants et Anti-
- Les antioxydants sont censés lutter directement contre les radicaux libres.
- Ils "cèdent" un électron aux radicaux libres, les stabilisant et les rendant inoffensifs avant qu'ils ne puissent endommager les cellules. Ils agissent comme des boucliers protecteurs au niveau moléculaire.
- Exemples : Vitamines C et E, polyphénols, glutathion, enzymes comme la SOD, catalase.
- Les anti-
inflammatoires (naturels ou de synthèse) - Ne luttent pas directement contre les radicaux libres, mais peuvent indirectement influencer leur production.
- Ils agissent sur les mécanismes de l'inflammation. L'inflammation est une réponse complexe du système immunitaire qui implique la libération de diverses substances chimiques (médiateurs inflammatoires) et l'activation de cellules immunitaires. Les anti-
inflammatoires modulent cette réponse pour réduire ses effets indésirables (douleur, gonflement, rougeur) et limiter les dommages tissulaires qu'une inflammation excessive ou chronique peut causer. - L'inflammation elle-
même peut générer des radicaux libres. En réduisant l'inflammation, les anti- inflammatoires peuvent donc indirectement réduire la production de radicaux libres qui découle de cette inflammation. Cependant, leur action principale n'est pas de piéger les radicaux libres directement, mais de moduler la cascade inflammatoire. - Exemples : Oméga-
3, curcumine, quercétine, gingembre, resvératrol.
En conclusion :
Les antioxydants défendent l'organisme contre les radicaux libres et le stress oxydatif, les anti-
Bien qu'ils aient des mécanismes d'action différents, ils sont souvent complémentaires dans la prévention des maladies chroniques, car le stress oxydatif et l'inflammation chronique sont des processus interdépendants qui se nourrissent mutuellement. Adopter un mode de vie sain et une alimentation riche en antioxydants et en composés anti-
LE STRESS ORIGINE DES RADICAUX LIBRES
Le stress (sous ses diverses formes) est un point de convergence majeur qui peut à son tour être un déclencheur significatif de la formation de radicaux libres et, par conséquent, du stress oxydatif, ainsi que de l'inflammation.
- Le Stress point de Convergence des Agressions ?
- Le terme "stress" est souvent utilisé dans un sens psychologique, mais il est important de l'entendre ici dans un sens plus large, comme une réponse non spécifique de l'organisme à toute demande qui lui est faite. Cette demande, ou "agression", peut être de diverses natures :
- Stress Psychologique / Émotionnel : Anxiété, dépression, surmenage, traumatismes, etc.
- Stress Physique : Blessures, infections, exercice physique excessif, privation de sommeil, températures extrêmes.
- Stress Chimique / Toxique : Exposition aux polluants, tabac, alcool, drogues, pesticides, médicaments.
- Stress Métabolique / Nutritionnel : Carences nutritionnelles, déséquilibres alimentaires (excès de sucre, graisses saturées), résistance à l'insuline, hyperglycémie.
- Lorsque l'organisme est soumis à l'une de ces formes d'agression, il active une série de réponses biologiques visant à maintenir l'homéostasie (l'équilibre interne). Ces réponses, bien qu'initialement adaptatives, peuvent devenir délétères si le stress est intense, prolongé ou chronique.
- Le Stress comme Déclencheur de la Formation de Radicaux Libres
- Le stress (notamment psychologique) active l'axe hypothalamo-
hypophyso- surrénalien (HPA), entraînant la libération de cortisol et d'autres hormones de stress. Si le cortisol est essentiel à court terme, une production chronique peut augmenter le catabolisme (dégradation des tissus), perturber le métabolisme et, indirectement, la production de radicaux libres. - Augmentation du métabolisme et consommation d'oxygène : Face à une agression, le corps peut augmenter son activité métabolique pour faire face à la demande. Une augmentation de la production d'énergie dans les mitochondries (respiration cellulaire) s'accompagne inévitablement d'une augmentation de la production de radicaux libres, car les fuites d'électrons sont inhérentes au processus.
- Activation du système immunitaire et inflammation : De nombreuses formes de stress (infections, blessures, stress psychologique chronique) activent le système immunitaire et déclenchent une réponse inflammatoire. Comme nous l'avons vu, les cellules immunitaires produisent des radicaux libres (éclatement oxydatif) pour combattre les menaces. Une inflammation chronique signifie une production chronique de radicaux libres.
- Épuisement des réserves antioxydantes : Un stress prolongé peut "user" les systèmes de défense antioxydants de l'organisme, soit en épuisant les précurseurs des enzymes antioxydantes, soit en consommant plus rapidement les antioxydants non enzymatiques (comme le glutathion, la vitamine C et E) pour neutraliser l'afflux de radicaux libres.
- Dommages directs par certaines toxines : Dans le cas du stress chimique (pollution, tabac, etc.), les agents agresseurs eux-
mêmes sont souvent des sources directes de radicaux libres ou des promoteurs de leur formation dans le corps.
- Le Stress comme Mécanisme Commun à la Plupart des Pathologies Chroniques
- En raison de ces liens étroits avec le stress oxydatif et l'inflammation, le stress chronique est aujourd'hui considéré comme un facteur majeur et unifiant dans l'étiologie et la progression de nombreuses maladies chroniques :
- Maladies cardiovasculaires : Le stress oxydatif et l'inflammation jouent un rôle clé dans l'athérosclérose. Le stress psychologique chronique est un facteur de risque reconnu.
- Maladies neurodégénératives : Le cerveau est particulièrement sensible au stress oxydatif et à la neuro-
inflammation, exacerbés par le stress chronique. - Cancers : Les dommages à l'ADN par les radicaux libres et l'inflammation chronique sont des facteurs de promotion du cancer.
- Maladies métaboliques (diabète, obésité) : Le stress oxydatif et l'inflammation sont impliqués dans la résistance à l'insuline et les dysfonctions métaboliques.
- Maladies auto-
immunes et inflammatoires : Le stress peut déclencher ou exacerber les réponses immunitaires dysrégulées. - Vieillissement prématuré : Le stress oxydatif est une des théories majeures du vieillissement.
Conclusion
- On peut raisonnablement affirmer que le stress, dans son sens large (englobant les agressions physiques, chimiques, psychologiques et métaboliques), est un point de convergence final majeur qui active et amplifie les processus de stress oxydatif et d'inflammation.
- Plutôt que d'être le "déclencheur unique" de la formation de radicaux libres (car la respiration cellulaire normale en produit toujours), il est plus juste de dire que le stress est un amplificateur puissant et un facteur prépondérant qui pousse la production de radicaux libres au-
delà des capacités de défense de l'organisme, créant un déséquilibre (le stress oxydatif) qui, à son tour, favorise et entretient l'inflammation chronique. - Comprendre cette convergence est crucial pour les approches de prévention et de traitement des maladies chroniques, soulignant l'importance de la gestion du stress global (alimentation, exercice, sommeil, gestion émotionnelle, exposition aux toxines) pour maintenir un équilibre redox et inflammatoire sain.
| Dèjeuner |
| Activitèes Pro |
| Trajet |
| La sieste |
| Le réveil |
| Le petit dèjeuner |
| L'habillage |
| La toilette |
| Trajet allée |
| Activités professionnelles |
| Souper |
| Distraction |
| Intimitée |
| Toilettes |
| Envirronement |
| Sommeil Nocturne |
| Prèparation à l'endormissement |
| Cycles du sommeil |
| Réveil |
| Sommeil et travail |
| Sommeil et lumiére |
| Sommeil et viellissement |
| Pathologies du sommeil |
| Thérapeutiques |